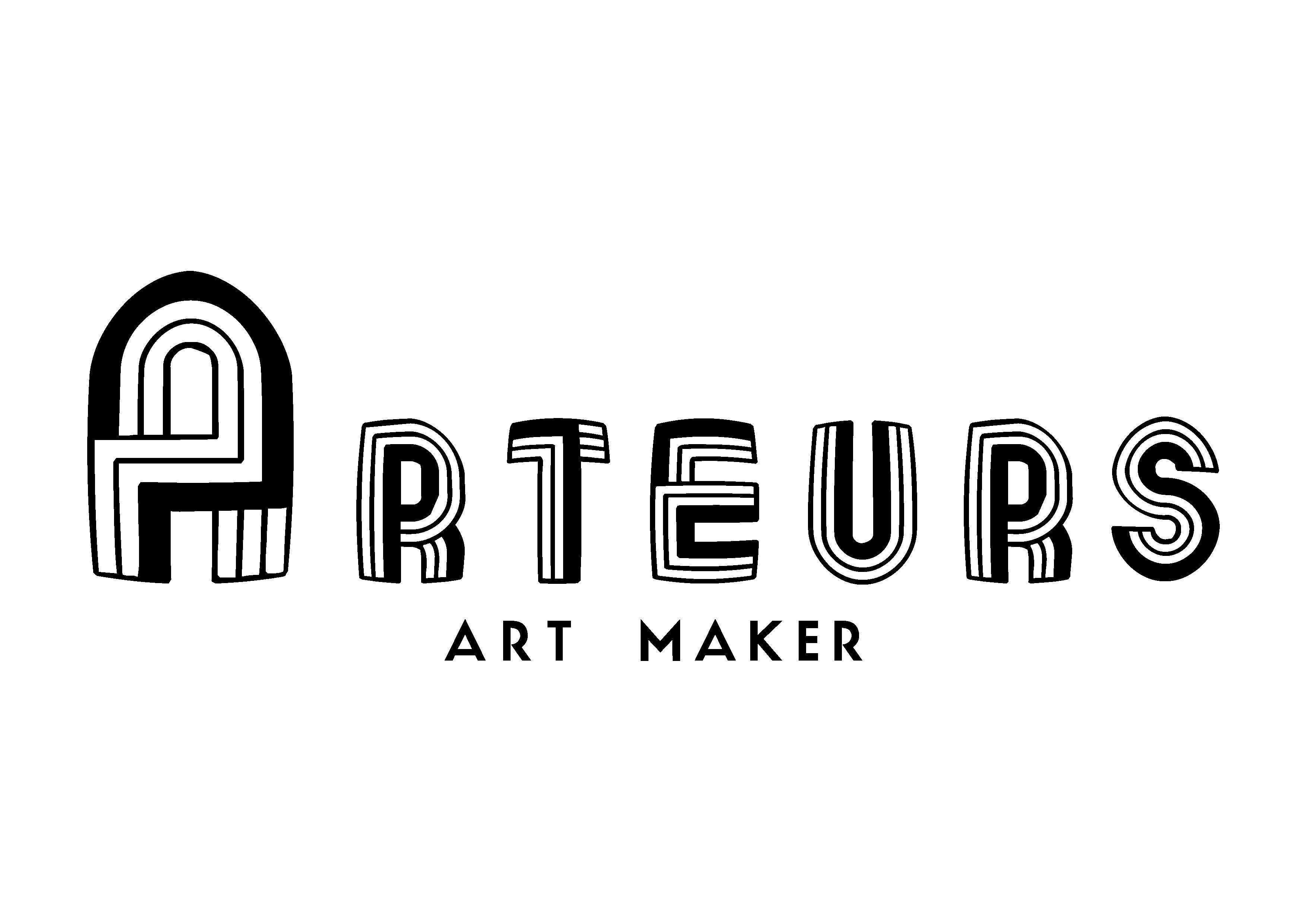Jin
Bo
Categorie
PEINTURE
Pays - Ville
FRANCE - CHINE
À PROPOS DE L'ARTISTE
Parfois le jour revient. Comme un après-midi d’hiver, des lueurs filtrent dans le brouillard. On se tient au centre de la toile, et l’évidence de l’eau vous enveloppe. La peinture de Jin Bo tient d’un moment lacustre, dans des cadres à demi effacés, un ponton mangé de brume. Ne vous étonnez pas d’entendre des voix, au travers de ces monochromes gris et bleutés. Le temps est ainsi fait. Il se conjugue au lieu, il imprègne le paysage et ceux qui l’habitent. Vivants ou fantômes, c’est sans importance. Les toiles de Jin BO croisent les époques, contemporaines ou abolies. Parfois des enfants jouent dans l’eau, ils rient, ils s’éclaboussent. Un train passe derrière le rideau d’arbres. Le peintre se souvient. De lui, de nous, du nord de la Chine, et d’autres endroits qui n’ont plus de nom.
“Je n’ai pas une très bonne mémoire, dit-il. Certaines choses ont commencé à s’effacer. Pour dire la vérité, mes toiles aujourd’hui tiennent aussi d’un album d’images.” Il en est ainsi de la vie, comme des lieux dans lesquels elle s’est déroulée. Les paysages n’échappent pas à cette amnésie progressive. Dans une série qui s’appelle “Métamorphose”, il peignait déjà en 2005, cette transformation du visage et des gestes, pris de stupeur, tenaillés par le doute, dans un cri, dans une grimace qui se dessine. Les humains sont comme les villes prises par le froid. “J’ai grandi dans le nord de la Chine et plus précisément à Tianjin. Les hivers y sont très froids, la lumière aussi. Pour le reste, tout a vraiment changé. Le passé n’existe plus et la modernité… je ne comprends pas cette modernité.”
Au fond, mieux vaut rester dans l’évanouissement de la toile et entretenir la discussion avec ce qui était. Mélancolie, comme sa dernière série, intitulée “Isolated Island” (2017-2020), et qui parle encore une langue endormie, à demi éteinte. Des mots lumière, des mots pénombre pour dire notre indécision d’humain, nos doutes, nos absences.


CE QUE LE TEMPS RETIENT DE LUMIERE
A la fin des années 80, Jin Bo avait à peine 11 ans, et il découvrait la peinture occidentale. Ce sont des années de construction, suggère-t-il, où “(je) découvre la Renaissance italienne, et cette étrangeté de la réalité qui (me) semblait sortie d’un rêve.” La Chine populaire ne tenait pas les mêmes repères. L’enfant s’initie, se familiarise à des couleurs différentes, puis il découvre un peu plus tard l’impressionnisme, l’abstraction et le conceptuel. “A ce moment-là, je me suis éloigné des livres, et des expositions aussi, parce que je voulais rester avec ma peinture et l’aider à se construire, sans influence.” Son arrivée en France n’a rien changé. Depuis quinze ans, il en est ainsi. Ce n’est pas un hasard si sa dernière série prend ce nom solitaire.
Jour après jour, la peinture se limite donc à l’essentiel. Sur la toile ne subsistent que le sentiment, la fluctuation du doute, en somme une humanité qui est le lien, la véritable lumière du travail. Sans doute que sa venue à la “Porte Grenade” tient là une part d’explication. Le partage de la lumière est un sentiment commun, que l’atelier toulousain entretient dans ses collaborations. “Je pense à ce que les éclairages de Kossi peuvent apporter à mon travail. Une toile éclairée, peut encore être lue de façon différente”, suggère alors le peintre.
Il s’agirait donc d’une possible parenté entre le tableau et le futur objet lumineux. L’éclairage viendrait de l’intérieur. En fait, l’oeuvre de Jin Bo fonctionne déjà de cette façon. Le paysage intérieur respire une clarté semblable à celle du paysage. C’est d’un sentiment qu’il s’agit, d’un souvenir fondateur ou d’une reminiscence voulue. La lumière de Kossi suit un chemin identique. Elle va dans la profondeur du tableau et révèle en partie l’intimité du lieu. En somme ce qu’il nous reste d’humanité.